Un bel article de Béatrice Decoop qui met en évidence que les valeurs du Compagnonnage restent contemporaines encore aujourd'hui.
Repenser le management : et si l’inspiration venait du compagnonnage ?
De nombreuses entreprises peinent à recruter et à fidéliser les jeunes, déplorant un engagement jugé fragile et des attentes perçues comme « exigeantes ». En 2022, une enquête MyJobGlasses × Ipsos indiquait que près d’un actif de 18–30 ans sur deux quittait son premier emploi dans l’année suivant son embauche. Ces départs renvoient à des réalités diverses : manque d’intérêt pour le poste, décalage avec l’idée initiale du métier, intégration insuffisante au collectif de travail, difficulté à faire sa place…
Entre logiques organisationnelles et aspirations des jeunes, il y a des rencontres qui parfois ne se font pas. Mais contrairement aux idées reçues, ce décalage n’est pas générationnel. De nombreuses enquêtes montrent que les nouvelles générations n’entretiennent pas un rapport au travail fondamentalement différent des autres. Les écarts s’expliquent davantage par des positions sociales et des parcours distincts (niveau de diplôme, catégorie socio-professionnelle), par les conditions dans lesquelles s’exerce le travail (pénibilité), par le stade du cycle de vie (début de carrière, parentalité, proximité avec la retraite…) .
Les organisations qui répondent le mieux aux défis démographiques sont celles qui mettent l’accent sur l’acquisition et le transfert de compétences, le sens du temps long, le management adossé à des valeurs, la proximité avec le “travail réel”, les échanges et la qualité du dialogue .
Ayant eu l’occasion à plusieurs reprises d’intervenir auprès des Compagnons, j’ai pu constater que les règles et les valeurs qu’ils défendent — sans cesse réinterrogées à l’aune des évolutions culturelles, technologiques et économiques — sont de nature à entrer en résonance avec les attentes des salariés, notamment les plus jeunes. Il ne s’agit pas de transposer le modèle du compagnonnage dans les entreprises, mais d’observer qu’il semble fournir un modèle en partie en phase avec les aspirations des salariés en quête de sens, de reconnaissance et d’un travail incarné.
Ce n’est pas un hasard si les métiers artisanaux gagnent en attractivité : 37 % des salariés envisageraient une reconversion, dont 51 % ont moins de 35 ans. Leurs motivations ? Fierté de produire, désir d’indépendance et quête de sens — avec l’idée qu’il s’agit de métiers correctement rémunérés et perçus comme moins exposés aux incertitudes liées à l’IA.
On constate que malgré son ancienneté, le compagnonnage est loin de relever du passé. Il peut au contraire apporter des repères aux entreprises qui réinterrogent leurs modèles de management : transmission intergénérationnelle, autonomie accompagnée, valeurs de confiance, d’entraide et de générosité — là où la « bienveillance », à force d’être invoquée, s’est peu à peu vidée de sa substance.
________________________________________
Quatre principes issus du modèle du compagnonnage en résonance avec les attentes contemporaines
● Autonomie construite : loin de l’injonction paradoxale à « être autonome » sans accompagnement, l’autonomie se conquiert progressivement grâce à l’expérience, l’encadrement et la transmission.
● Autorité incarnée : les jeunes rejettent l’autorité purement statutaire mais recherchent des figures légitimes, capables d’inspirer par leur compétence et leur exemplarité.
● Équilibre de vie : le métier ouvre des chemins d’accomplissement sans réduire l’individu à sa seule fonction productive.
● Sens du travail : au lieu de la fragmentation des tâches, le compagnonnage valorise la maîtrise d’un processus finalisé, le respect des matériaux et une conscience écologique.
Une autonomie construite
L’une des caractéristiques des sociétés contemporaines est d’exposer les jeunes à une injonction précoce à l’autonomie. On attend d’eux qu’ils sachent « se débrouiller seuls », qu’ils puissent « tenir » dans un monde complexe où les trajectoires ne sont plus tracées d’avance. Or, cette autonomie, présentée comme une exigence individuelle, ne peut s’acquérir sans accompagnement. Les jeunes ont besoin de la médiation des adultes , de repères et de figures d’appui pour se construire. L’orientation professionnelle, l’entrée dans des métiers aux contours incertains, la confrontation à un monde du travail opaque sont autant d’épreuves qui révèlent ce besoin de cadre.
Dans ce contexte, le compagnonnage propose une forme d’encadrement qui se veut à la fois exigeant et protecteur. La discipline qu’il instaure fournit des règles et un horizon de sens dans lequel s’inscrire. Ce cadre s’incarne dans une communauté de valeurs — fraternité, transmission, respect, intégrité — qui offre aux jeunes un socle stable pour se structurer et gagner en confiance. Parce que pour les compagnons, « Former, c’est non seulement transmettre des techniques, mais aussi inspirer un idéal et un sens de la responsabilité […]. Il est nécessaire de créer un environnement inclusif et respectueux, où les connaissances et les compétences sont partagées. »
De nombreuses organisations cultivent, quant à elles, un paradoxe : un contrôle excessif sur l’exécution du travail (micro-management), tout en laissant les nouveaux entrants sans ou avec trop peu d’accompagnement. Une enquête de l’Observatoire national du premier emploi (mars 2022) révèle que plus de 80 % des 18-30 ans regrettent de ne pas avoir été soutenus lors de leur intégration, 39 % de n’avoir bénéficié d’aucun processus d’accueil ; 94 % des jeunes en alternance déplorent, quant à eux, n’avoir eu aucun parcours spécifique.
A l’inverse d’une autonomie prescrite, le compagnonnage incarne une logique d’autonomie construite avec les pairs et guidée par les sédentaires. L’itinérant est placé dans une situation où il peut prendre des initiatives, expérimenter et même se tromper. L’erreur n’est pas disqualifiante : elle doit être perçue comme une ressource pour l’apprentissage. Selon Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, l’autonomie ne se réduit pas à l’absence de contraintes : elle suppose un cadre éducatif, des repères et une progression, une pédagogie de l’émancipation.
C’est à ce titre que le compagnonnage peut être lu comme un modèle qui n’impose pas son autorité par la seule force du statut, mais sous la forme d’un ascendant moral (dans le sens d’éthique) et professionnel, nourri par l’expérience, la compétence et l’attention portée à l’autre. Il ne cherche pas à contraindre, mais à accompagner : montrer le chemin, soutenir les apprentissages (perfectionnement technique, savoir-être) et ouvrir à l’autonomie.
En ce sens, le compagnonnage incarne un idéal d’autorité qui résonne avec les attentes contemporaines. Loin de la domination, il met en scène une relation d’asymétrie constructive : celle d’un professionnel aguerri qui, par la force de son savoir-faire et la justesse de son engagement, exerce une autorité reconnue et acceptée. Une autorité qui, précisément parce qu’elle est vécue comme juste, permet aux jeunes de grandir et de trouver leur place.
Cette posture suppose une disponibilité : « Nous avons besoin de nous arrêter pour écouter et nous mettre au niveau des jeunes, en les respectant. Démarche volontaire pour prendre le temps, notre temps. »
L’exigence n’exclut pas une quête d’équilibre
L’aspiration à concilier vie professionnelle et vie personnelle n’est pas une invention des jeunes générations, mais elle s’exprime aujourd’hui avec une intensité particulière. Dans l’après-guerre, le surinvestissement dans le travail apparaît comme la norme : il s’agit à la fois de participer à l’effort collectif de reconstruction et de saisir les opportunités d’ascension offertes par la croissance. La promotion sociale se traduit alors par une implication totale dans le travail, perçu comme le principal levier d’accomplissement et de réussite.
Même si le travail demeure de nos jours une dimension centrale de l’existence — parce qu’il détermine la place de chacun dans la société et structure largement les rythmes de vie —, les enquêtes montrent qu’il n’est plus envisagé comme un absolu . Les individus ne souhaitent plus tout lui sacrifier : ils cherchent désormais à l’inscrire dans un équilibre de vie. Le travail tend ainsi à être perçu non plus comme une fin en soi, mais comme une activité qui doit s’articuler avec d’autres dimensions de l’existence : la vie familiale, amicale, les loisirs...
Cette quête d’équilibre trouve une résonance dans la tradition compagnonnique condensée dans la devise « Ni s’asservir, ni se servir, mais servir ». Le métier ne doit pas être un instrument de domination ni un moyen d’enrichissement égoïste, mais une voie pour se mettre au service d’un idéal commun.
Les travaux de l’historien Jean-Michel Mathonnière, spécialiste du compagnonnage, rappellent combien les Compagnons ont toujours valorisé des vertus comme l’humilité, la mesure et la modération, considérées comme constitutives de la réussite personnelle.
Dans un ouvrage de référence, Les Compagnons du Devoir (Éditions Ouest-France, 2000), cette tradition est décrite comme une transmission non seulement de savoir-faire, mais aussi de valeurs et de manières d’être. Le métier est mis « au service de l’homme » : il ne se réduit pas à une compétence technique mais constitue un vecteur de construction individuelle et de lien social.
Ainsi, bien avant que la notion contemporaine de « qualité de vie au travail » ne se généralise, le compagnonnage affirmait déjà l’importance de l’équilibre, de l’humilité et de la responsabilité. Ce cadre, qui articule l’exigence professionnelle avec une sagesse de vie, fournit un cadre de lecture actuel des attentes partagées entre générations.
"En cultivant l'humilité et en acceptant nos limites, nous évitons de devenir esclaves de nos ambitions." Cette sagesse rejoint l’aspiration contemporaine à un bien-être global et à une carrière au service d’un projet de vie, et non l’inverse.
Le compagnon, une incarnation de l’autorité contemporaine
Le rapport à l’autorité a profondément évolué au cours des dernières décennies. Si, dans les sociétés traditionnelles, l’autorité s’exerçait principalement sur un mode statutaire — celui du chef, du magistrat, de l’enseignant ou du cadre —, les nouvelles générations rejettent aujourd’hui les formes d’autorité fondées uniquement sur la fonction et la contrainte.
Cette autorité reposait sur le droit de commander, d’imposer l’obéissance et de sanctionner, dans le cadre d’une relation hiérarchique marquée par l’inégalité et la domination. Ce modèle fonctionnait tant que ceux qui y étaient soumis l’acceptaient ou le toléraient, mais il révélait aussi sa fragilité lorsque la résistance prenait la forme de contestation ou de révolte.
À partir de 1968, la remise en question des institutions a accéléré le déclin de l’autorité statutaire. Progressivement, une autre logique s’est imposée : l’autorité ne va plus de soi, elle doit se prouver, se négocier. Les enfants sont encouragés à s’exprimer, à développer leur singularité ; l’éducation se recentre sur l’individu et ses besoins. Dans ce contexte, l’autorité qui inspire et qui « en impose » a pris le pas sur celle qui cherche à « imposer ». L’autorité s’exerce alors par ascendant, c’est-à-dire une légitimité reconnue non pas en vertu d’un statut formel, mais en raison de qualités personnelles, de compétences et d’exemplarité. Elle repose sur l’adhésion et la confiance plutôt que sur la contrainte.
Les jeunes générations, socialisées dans ce contexte, recherchent moins des chefs que des figures légitimes : des managers-piliers, reconnus pour leur compétence et leur capacité à transmettre. C’est ce guide inspirant qu’ils décrivent lorsqu’ils expriment leurs attentes ou évoquent leurs meilleures expériences en entreprise.
Le compagnonnage illustre cette autorité d’ascendant : l’expérience et la transmission fondent la légitimité, soutenue par la disponibilité et l’écoute. "Nous avons besoin de nous arrêter pour écouter et nous mettre au niveau des jeunes, en les respectant. Démarche volontaire pour prendre le temps, notre temps."
Le sens au cœur du métier et du modèle du compagnonnage
Souvent présentée comme propre aux jeunes générations, la quête de sens au travail traverse en réalité toutes les générations. Ce qui change aujourd’hui, c’est sa visibilité et l’exigence accrue de cohérence : comprendre la finalité de son activité, éprouver des affinités avec ce que l’on fait, se sentir utile à la société.
Le travail contemporain, fragmenté et spécialisé, réduit souvent l’individu à un simple maillon, privé de la vision d’ensemble. À l’inverse, le travail du compagnon couvre l’ensemble du processus avec le client, de la formulation du besoin à la livraison de l’ouvrage.
On associe spontanément le compagnonnage à l’excellence technique et au savoir-faire. Réduire cette tradition à la seule maîtrise du geste serait passer à côté de son essence. Le compagnonnage, c’est avant tout une manière d’être au monde et aux autres : un apprentissage du savoir-être, inscrit dans une communauté de valeurs qui ne vise pas seulement à former de brillants artisans (il faut d’ailleurs détenir un premier diplôme dans le métier pour rejoindre les compagnons), mais à construire des hommes et des femmes capables de s’inscrire dans une histoire commune, de transmettre et de servir un idéal collectif.
Cette tradition, aujourd’hui enrichie d’une conscience écologique — respect des matériaux, refus de l’obsolescence, responsabilité envers l’environnement — inscrit le métier dans une dynamique où la technique et la transmission se doublent d’une réflexion sur l’impact même de l’activité humaine. Le travail y apparaît non pas seulement comme une activité productive mais un vecteur de construction de soi et de lien social.
Conclusion
Dans un contexte où les entreprises cherchent à fidéliser et engager les jeunes, le compagnonnage rappelle la puissance d’un modèle fondé sur le mentorat, la transmission et le sens du collectif.
Il rappelle que l’apprentissage ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques, mais englobe aussi la transmission de dispositions, de savoir-être et de valeurs collectives.
L’intérêt n’est pas de reproduire le modèle, mais d’en saisir la logique sociale : articuler formation et socialisation, exigence et accompagnement, autonomie et appartenance. À ces conditions, l’entreprise devient non seulement un espace de production, mais aussi un milieu d’apprentissages continus et de reconnaissance — ce dont témoignent les attentes des jeunes comme celles de leurs aînés.
« Former, c’est non seulement transmettre des techniques, mais aussi inspirer un idéal et un sens de la responsabilité […]. Il est nécessaire de créer un environnement inclusif et respectueux, où les connaissances et les compétences sont partagées. »
"C’est sur son chemin intérieur que chacun construit le véritable chef-d’œuvre de sa vie."
Un chef-d’œuvre que le compagnonnage invite à réaliser, en conjuguant liberté individuelle et service d’un idéal commun.
Béatrice Decoop
Fondatrice de So Youth !


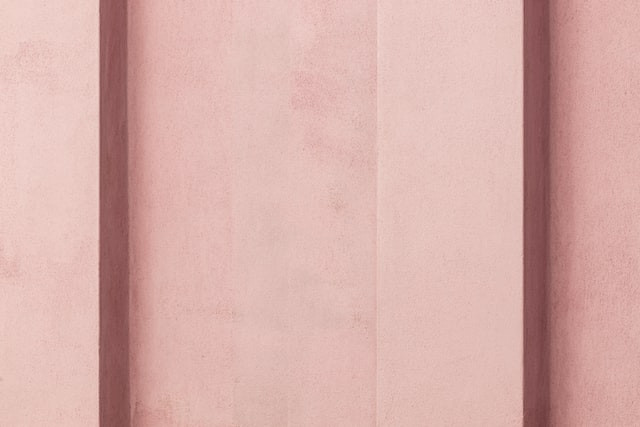








Pour laisser un commentaire, veuillez vous connecter ou vous inscrire.
S’inscrireSe connecter