Du 8 au 16 juillet dernier, se tenait dans les locaux d’Euratechnologies, à Lille, l’exposition Hermès in the making. J’ai eu l’occasion d’y parcourir les allées.
Récit d’une déambulation.
14H : J’arrive dans l’écoquartier et je découvre un bâtiment chargé d’histoire qui accueille l’exposition. En effet, elle prend place dans le hall de l’ancienne filature de coton Le Blan-Lafont, construite en 1896. Celle-ci ferme en 1989 et devient alors une friche industrielle pendant près de 20 ans, avant d’être réhabilitée pour accueillir le futur pôle d’excellence destiné aux nouvelles technologies de l’information et de la communication : Euratechnologies, inauguré en 2009.
14H15 : J’assiste à la fin de la présentation du stand « Imprimer la soie ».
La démonstration est terminée, le carré, qui a fait la réputation d’Hermès, est imprimé, l’un des artisans échange de manière enthousiaste et ludique avec les visiteurs agglutinés autour de la table. « Quelle est l’étape après la fixation de la couleur ? », « Comment s’appelle le type d’ourlet réalisé par les couturières ? », « le réalise-t-on envers sur endroit ou endroit sur envers ? »…
14H40 : Je poursuis ma visite et m’arrête au prochain stand à quelques mètres de là.
Une sellière-harnacheuse, munie d’une petite éponge imbibée d’eau, détend le cuir d’un des deux panneaux de la selle en cours d’assemblage. Après l’avoir retendu et galbé, elle le coud ensuite directement à la mousse.
Tout en réalisant ses gestes avec minutie, elle répond posément aux questions qui s’élèvent autour d’elle : il faut ainsi pas moins d’une semaine pour assembler une selle ; tous les points, sauf les coutures décoratives, sont réalisés à la main ; chaque selle est confectionnée sur-mesure par rapport au cheval, au cavalier et à la discipline pour laquelle elle sera utilisée (dressage, cross, saut d’obstacle…)… Derrière elle, j’observe un écorché des différentes pièces de la selle.
15H : Je continue.
Des enfants montent sur les différentes selles exposées et distinguées par disciplines et se font photographier par leurs parents.
Sur une table, des petits jeux en bois pour tester la dextérité à deux sont laissés en libre-service.
Une carte géante lumineuse de la France montre la localisation des différents ateliers Hermès, un écran interactif permet de sélectionner les savoir-faire ou les régions.
Un espace d’expérimentation animé par une artisane, invite les visiteurs à s’essayer au point sellier. La démonstration a déjà eu lieu. Les apprentis en herbe choisissent leur cuir et leur couleur de fil avant de placer leur pince à coudre entre leurs jambes. Elles pré-percent leur matière avec appréhension et commencent la couture. Pas si simple pour des débutants.
15H30 : Je retourne au stand d’impression sur soie pour assister à toute la démonstration de sérigraphie.
Les artisans, tout spécialement venus de Lyon pour l’exposition, changent de motif pour un dessin de la nouvelle collection automne-hiver 2023.
Tandis que l’un fait danser les cadres de sérigraphie pour imprimer un motif qui se dévoile couleur après couleur, l’autre nous plonge dans l’histoire d’Hermès, la création et les valeurs de l’entreprise, la place de l’artisanat, du savoir-faire et de l’expertise de la main, le processus de fabrication d’un carré, de l’élevage du ver à soie à la vente dans les différents magasins en fonction de la clientèle locale, en passant par la conception du dessin par les designers freelance et par la sérigraphie réalisée par des artisans formés pendant 3 ans en interne.
16H30 : J’écoute attentivement l’infographiste qui nous explique comment elle transforme le dessin réalisé par le freelance, destiné à la prochaine collection de foulards, en calques numériques qui serviront à l’élaboration des cadres de sérigraphie. Elle retrace précisément les traits et sépare les différentes couleurs qui composeront le carré.
Les motifs étant particulièrement complexes, un carré se décompose généralement en 25 à 30 couleurs, certains peuvent même atteindre les 48 couleurs. Soit autant de calques numériques puis de cadres de sérigraphie pour un seul et même dessin.
16H45 : Après un arrêt à la bibliothèque dans laquelle les livres sont en libre consultation et à l’animation de sérigraphie d’affiches, en souvenir de l’exposition, je me dirige vers l’espace matériauthèque puis Petit H. Des objets parfois loufoques y sont présentés : masques de nuit en foulards, chaise à partir d’un arçon de selle, balançoire à base d’étriers, salière en bouton, miroir et pièce en cristal, cravate en bandoulière de sac… Des designers et artistes récupèrent les pièces qui ne peuvent être réparées ou qui ne passent pas les nombreux contrôles qualités, pour créer de nouveaux objets fonctionnels.
17H00 : Je repasse devant l’animation « apprentissage de la couture sellier », plusieurs groupes se sont succédé depuis la première fois que je me suis arrêtée. Les visiteurs regardent assidument les gestes de l’artisane qu’ils vont devoir reproduire plus tard.
Quelques jours auparavant, la peinture sur porcelaine était proposée comme animation dans cet espace.
Je me tourne vers une nouvelle démonstration : l’horloger assemble patiemment les éléments qui composent sa montre à l’aide d’une pince « brucelles ». Un écran propose en direct une image largement agrandit de son ouvrage.
J’avance vers le prochain stand où une maroquinière-réparatrice nous explique les différentes étapes de réparation d’une anse sur un sac Kelly, emblématique de la marque. Chaque année, plus de 200000 objets hermès sont rapportés en magasin et confiés aux artisans réparateurs pour leur donner un nouvel éclat.
17H25 : Stand suivant.
Je regarde la maroquinière fileter la bandoulière de son sac Kelly. Elle explique ses gestes tout en les faisant.
Tous les sacs de la maison Hermès sont fabriqués à la main en France. En moyenne, une nouvelle maroquinerie est inaugurée tous les ans, depuis 2010. La dernière en date a été inaugurée en mai dernier dans les Ardennes, seulement 1 mois après celle de Louviers en Normandie. Quatre autres sites de production sont prévus dans les prochaines années, dans le Puy-de-Dôme, en Charente, en Gironde et une autre dans les Ardennes.
17H35 : Je contemple la peintre travailler sur sa porcelaine. Elle se lève pour répondre aux questions de ses admirateurs puis reprend ses pinceaux.
Elle joue avec sa palette de bleus, avec l’intensité, la transparence et l’opacité de ses pigments qu’elle dépose par petites touches sur son assiette.
17H45 : Il ne me reste plus que deux stands à découvrir.
Je me dirige vers la sertisseuse de bijoux.
À l’aide de ses outils et de sa loupe binoculaire, dont les images sont retransmises sur un écran, elle vient agrandir les emplacements de chaque pierre avant de les positionner délicatement. Elle prend ensuite une échoppe pour pousser les grains de métal contre la pierre pour la sertir, seulement 2 grains tiennent la pierre.
18H : Je termine mon parcours par le façonnage des gants.
L’artisan, un coupeur-gantier venu de la seule ganterie Hermès en France, située dans le Limousin, nous présente les 22 étapes nécessaires à la fabrication d’une paire de gants, puis les différences entre les différents modèles femme et homme.
La peau, qui n’accueillera qu’une seule paire de gants, est travaillée, étirée, tendue et mesurée. Les pièces savamment positionnées sont ensuite coupées à la « main de fer », emporte-pièce inventé au XIXème siècle et ressemblant étrangement à un outil de torture, puis cousues et assemblées à la doublure (seulement au bout des doigts et au poignet pour la changer facilement si elle est abimée) avant d’être lissées sur une main chauffante.
18H30 : Après un dernier tour rapide de l’exposition et un dernier coup d’œil aux artisans, je quitte les lieux.
Malgré un espace assez exigu, j’ai passé plus de 4 heures à déambuler entre les stands, à observer l’évolution des ouvrages, à m’émerveiller devant le travail de la main, à découvrir d’un œil enfantin les démonstrations et à écouter les artisans passionnés. Le visiteur n’est pas dans un modèle classique d’exposition, il vit une véritable expérience vivante.
Démonstrations d’artisans, animations, jeux et coloriages, vidéos, matériauthèque et bibliothèque, témoignages et anecdotes audios, espace d’expérimentation… les médias sont variés pour sensibiliser le tout public au savoir-faire et à l’artisanat local, sans pour autant vulgariser le vocabulaire spécifique.
On sent les visiteurs admiratifs et impressionnés par l’expertise de la main et j’ai entendu de nombreux jeunes interroger les artisans sur leur formation.
Ce genre d’expositions pourraient-elles faire naitre de nouvelles vocations ?
https://www.hermes.com/fr/fr/story/317970-hermes-in-the-making-lille/



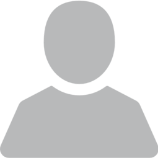







Romain Recopé
Maeva Chapelle